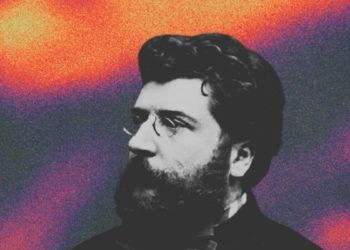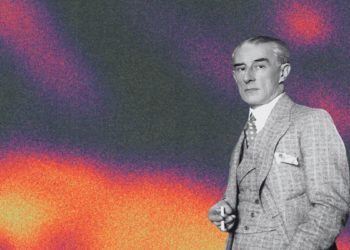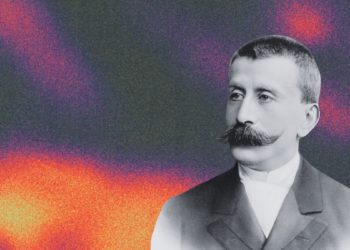Venir à Salzbourg pendant l’été, c’est chaque année retrouver intacte la beauté d’une composition picturale unique : la pierre blanche de la forteresse de Hohensalzburg se détachant sur l’horizon bleuté des pré-alpes autrichiennes. C’est retrouver aussi le plaisir de marches méditatives dans ces prairies d’altitude, véritable trésor national, entretenues avec passion comme des petits golfs sans trous, et qui servirent jadis de décor bucolique à une comédie musicale ayant fait connaître Mary Poppins et les notes de la gamme à tous les enfants du monde.
Venir à Salzbourg pendant l’été, c’est enfin perpétuer la tradition d’un festival de musique vieux de plus d’un siècle, et s’offrir une parenthèse onirique dans un écrin d’Histoire et de Nature.

Notre déambulation musicale commence par la grande salle du Mozarteum, l’un des nombreux points de chute qu’offre la ville à ses festivaliers, par un concert de musique de chambre consacré à Schubert et à ses deux trios : l’op.99 et l’op.100, composés en 1827, quelques mois seulement avant sa mort. Sir Andràs Schiff est au piano, en habitué des soirées salzbourgeoises, accompagné de ses amis Erich Höbarth au violon et Christophe Coin au violoncelle.
À noter la présence sur scène d’un remarquable pianoforte de 1820, bel objet de collection, qui ravirait les antiquaires autant que les adeptes d’une musique « historiquement informée ». Le son dudit piano surprend d’abord par son volume sonore, nécessairement moins puissant que celui des pianos modernes, avec leur machinerie parfois lourdingue ; mais l’oreille s’habitue bien vite à cette nouvelle ambiance sonore, plus feutrée, plus intimiste, et les aigus ressortent finalement de manière très cristalline sous les doigts cotonneux d’un Andràs Schiff. Malgré les « divines longueurs » de ces deux trios, comme aurait pu dire Schumann à leur propos, notre ensemble de ce soir se distingue par une homogénéité des parties et du tempo qui est la marque des grands professionnels : chaque instrument trouve aisément sa place dans cet enchevêtrement de thèmes et de modulations, caractéristiques du dernier Schubert. L’andante con moto du trio op.100, l’une des pages les plus belles du compositeur, avec son ineffable mélancolie douce, restera comme l’un des grands moments d’émotion du concert.
Le lendemain – même lieu, même heure, mais pas même piano – voici venir Arcadi Volodos pour un récital des plus intrigants, composé pour une large part de pièces courtes ou relevant d’une esthétique miniaturiste.

Il en va ainsi du cycle de la Musica Callada, une série de vingt-huit petites pièces composées dans les années 1950-60 par le compositeur barcelonais Federico Mompu. Dans ce répertoire très méditatif, parfois proche du silence, où pointent çà et là quelques réminiscences de Debussy, Arcadi Volodos nous fait entrer dans un monde étonnant, fait d’ombres et de lumières, comme des épures posées sur une toile.
L’occasion rêvée pour lui de nous démontrer toute la subtilité de son jeu de pédales, toute sa science des plans sonores, qui en font à n’en pas douter l’un des pianistes majeurs de notre époque. Mais cette qualité très impressionniste de son jeu ne se fond pas dans tous les répertoires : ainsi dans la Deuxième Ballade de Liszt, une œuvre plus longue et plus charpentée, on regrettera une sonorité un peu maniérée, cherchant souvent à mettre de l’effet là où il n’y en a pas, quitte à disloquer le discours et la forme.
Après la pause, place à Scriabine et à un florilège de Préludes, de Danses, de Poèmes, couronné par la Dixième Sonate et par Vers la flamme, l’une de ses pièces les plus…enflammées. Volodos y retrouve son terrain de jeu favori, et nous fait adorer cette musique venue d’ailleurs, nous emmenant toujours plus loin dans un délire mystique dont il serait l’unique medium terrestre. Se jouant de la complexité de ces pages à l’énergie sombre et radioactive, le génie de Volodos est de parvenir toujours à nous en garder intact l’élément de tension vers la clarté qui les traverse toutes… Du grand Scriabine, comme on n’en avait jamais entendu.
Le lendemain, en guise de point d’orgue à notre déambulation salzbourgeoise, rendez-vous nous était donné à la Haus für Mozart pour écouter Benjamin Bernheim et Sarah Tysman, dans un de ces Liederabend consacrés exclusivement au répertoire pour voix et piano. Le programme commence par le cycle des Dichterliebe de Schumann – brillamment exécuté mais manquant un peu d’élan et de fraîcheur printanière. Un choix de tempo plutôt tranquille, qui met bien en valeur la diction de Benjamin Bernheim dans le médium, mais qui pousse nos deux interprètes à livrer une version un peu trop plaintive des vers de Heine.

La deuxième partie du programme, intégralement composé de musique française, avec Duparc et Chausson, ne nous emportera pas non plus : trop longue, trop touffue, surtout dans le Poème de l’Amour et de la Mer de Chausson.
Il faut croire que les vapeurs vénéneuses du Scriabine de la veille font encore leur effet, et que nos oreilles peinent à s’habituer à tout autre répertoire, aussi joli soit-il…
Espérons que d’ici l’année prochaine, nous soyons désintoxiqués, et que nous puissions réentendre la douce mélodie du bonheur salzbourgeoise!
Samuel AZNAR, 2023